[Dans l'attente d'un compte-rendu du livre d'Edouard Leport, voici déjà un extrait reproduit avec son aimable autorisation]
L’un des outils les plus dangereux et les plus efficaces pour neutraliser l’opposition des enfants et des mères aux demandes des pères est le « syndrome d’aliénation parentale », abrégé en SAP et parfois euphémisé en « aliénation parentale », « exclusion parentale » ou « emprise et manipulation mentale d’un parent sur l’enfant ».
Le « syndrome d’aliénation parentale » est décrit pour la première fois en 1985 par son inventeur, le psychiatre et psychanalyste étasunien Richard Gardner, comme « un trouble propre aux enfants, survenant quasi exclusivement dans les conflits de droit de garde, où un parent (habituellement la mère) conditionne l’enfant à haïr l’autre parent (habituellement le père). Les enfants se rangent habituellement du côté du parent qui se livre à ce conditionnement, en créant leur propre cabale contre le père[1]». Gardner a forgé cette définition à partir de pseudo-constats dont il ne donne jamais de preuves empiriques. Il affirme ainsi que 90 % des enfants dont les parents se disputent la résidence souffrent du syndrome d’aliénation parentale ; que la majorité des allégations de violences sexuelles sur enfant faites dans le cadre de conflits sur la garde des enfants sont fausses ; que 90 % des fausses allégations sont le fait des mères.
Il se propose alors de créer des outils pour déterminer si les accusations de violences sexuelles formulées par les enfants sont vraies ou fausses, tout en partant du principe qu’elles sont fausses à 90 % dans le contexte des séparations conjugales. Le fondement circulaire et autojustificatif du raisonnement est donc éclatant dès le départ.
Un autre aspect particulièrement problématique dans le raisonnement de Gardner est qu’il considère que les « paraphilies » (les comportements sexuels prédateurs[2]) des êtres humains sont des mécanismes naturels d’adaptation qui favorisent la procréation et assurent donc la survie de l’espèce humaine[3]. Il avance également que les femmes seraient disposées à être traitées violemment, voire violées par des hommes, car ce serait le prix à payer pour « recevoir du sperme » et donc participer à la procréation. En plus de la misogynie qui transpire dans ces propos, la dimension tautologique du raisonnement est encore une fois évidente : si l’inceste, le viol et les violences sexuelles en général ne sont pas considérés comme des sévices intolérables, alors leur dénonciation n’est ni indispensable ni légitime. Ces actes, supposés être dans la nature humaine, ne justifient pas, selon Gardner, le rejet de leur père par les enfants qui en sont victimes.
Contrairement à ce qu’affirment les partisans du syndrome d’aliénation parentale, et comme le montrent de nombreuses sources répertoriées par la juriste états-unienne Jennifer Hoult[4], il n’y a jamais de vagues de fausses accusations contre des pères, ni pendant les procédures de divorce ou de séparation ni en dehors. À cet égard, il est intéressant de noter que Gardner formule sa théorie du syndrome d’aliénation parentale dans les années 1980 aux États-Unis – une période où de très nombreuses accusations de violences sexuelles sur les enfants ont été médiatisées et se sont révélées vraies pour leur immense majorité. Les dénonciations d’incestes et de violences intrafamiliales avaient alors commencées à être prises au sérieux et les auteurs de ces actes avaient dû en assumer les conséquences devant la justice. La théorie de Gardner permettait de préserver l’impunité des hommes auteurs de ces violences sexuelles sur leurs enfants en accusant les mères d’avoir manipulé ces derniers pour les faire mentir[5].
Lire la suite
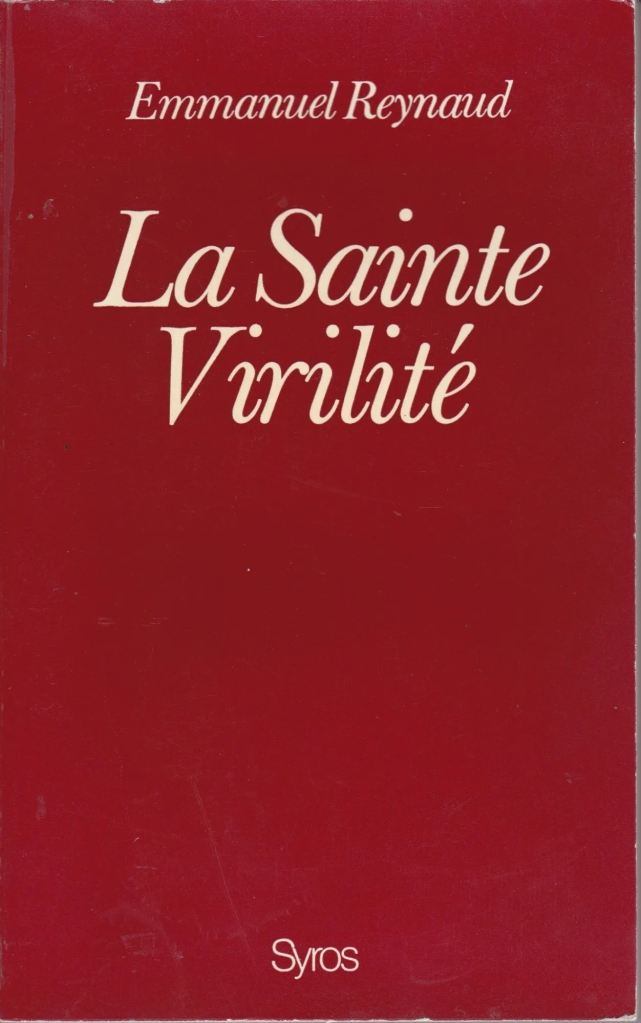




 L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.
L’inconfort de l’engagement proféministe a plusieurs dimensions mais il est bien évidemment mineur et ridicule pour les questions qui nous concernent ; à savoir les conditions de vie des femmes, qui rappelons-le consistent en de l’exploitation domestique, salariale, sexuelle, des violences, entre autres sexuelles, ou des meurtres. Ça ne se résout pas avec quelques politiciens qui, pour exprimer leur solidarité à une journée de luttes féministes, posent et « transgressent le genre » sur une affiche avec du rouge à lèvres.
